Bridgerton : une saison 4 encore plus inclusive (et ça va faire rager les anti-woke)
Écrit par Jérôme Patalano - Publié le 13 novembre 2025 - 🕐 6 minutes
Netflix vient d’officialiser la date de diffusion de la saison 4 de Bridgerton : rendez-vous le 29 janvier 2026 pour la première partie, puis le 26 février pour le final.
Cette annonce marque un tournant historique pour la série : après trois saisons d’hétéronormativité bien polie, les arcs queers de la saison 3 promettent enfin de pleinement s’affirmer.
Ce qui sera abordé :
Depuis sa création, Bridgerton a toujours été le bijou inclusif de Shonda Rhimes, qui a osé réécrire l’histoire de la Régence britannique en y injectant une diversité raciale. Fini le tout blanc compassé des séries d’époques traditionnelles. Dès 2020, la série propose un casting multiracial sans complexe : un duc noir, une reine métisse, des familles sud-asiatiques. Le pari ? Refléter le monde tel qu’il est aujourd’hui, pas celui fantasmé des manuels d’histoire.
Pour la productrice de Grey’s Anatomy, ce choix n’est pas un simple effet de manche : c’est une conviction profonde. Comme elle l’a plusieurs expliqué, créer des univers où tout le monde se ressemble reviendrait à effacer une partie de l’humanité, et sa société de prod, Shondaland, refuse d’entrer dans ce jeu. La saison 2 a même poussé le curseur plus loin en donnant des origines sud-asiatiques à la famille Sharma, montrant ainsi que les valeurs anglaises n’étaient pas les seules dignes d’intérêt…

Une série hot… qui ne s’assume qu’à moitié
Parlons franchement : Bridgerton, c’est du sexe en corset, des bals sensuels et un casting à nous faire chauffer l’entre-jambes. Les scènes torrides entre Daphné et le duc, puis entre Anthony et Kate, ont fait grimper la température de millions d’entre nous. Netflix a compris la recette : un mélange savant de romance époque Jane Austen et de Gossip Girl sous stéroïdes érotiques. Résultat ? Des records d’audience et des conversations enflammées sur les réseaux sociaux. Mais jusqu’à la saison 3, la série restait coincée dans un moule hétéronormatif. Certes, Henry Granville, ami de Benedict, était ouvertement gay dès la saison 1, mais son histoire n’était qu’un décor de fond. Un personnage secondaire pour cocher la case diversité sans vraiment bousculer les codes du genre. La frustration montait chez les fans queers qui réclamaient plus : une vraie représentation, pas des miettes.
Nouveau
5,49€
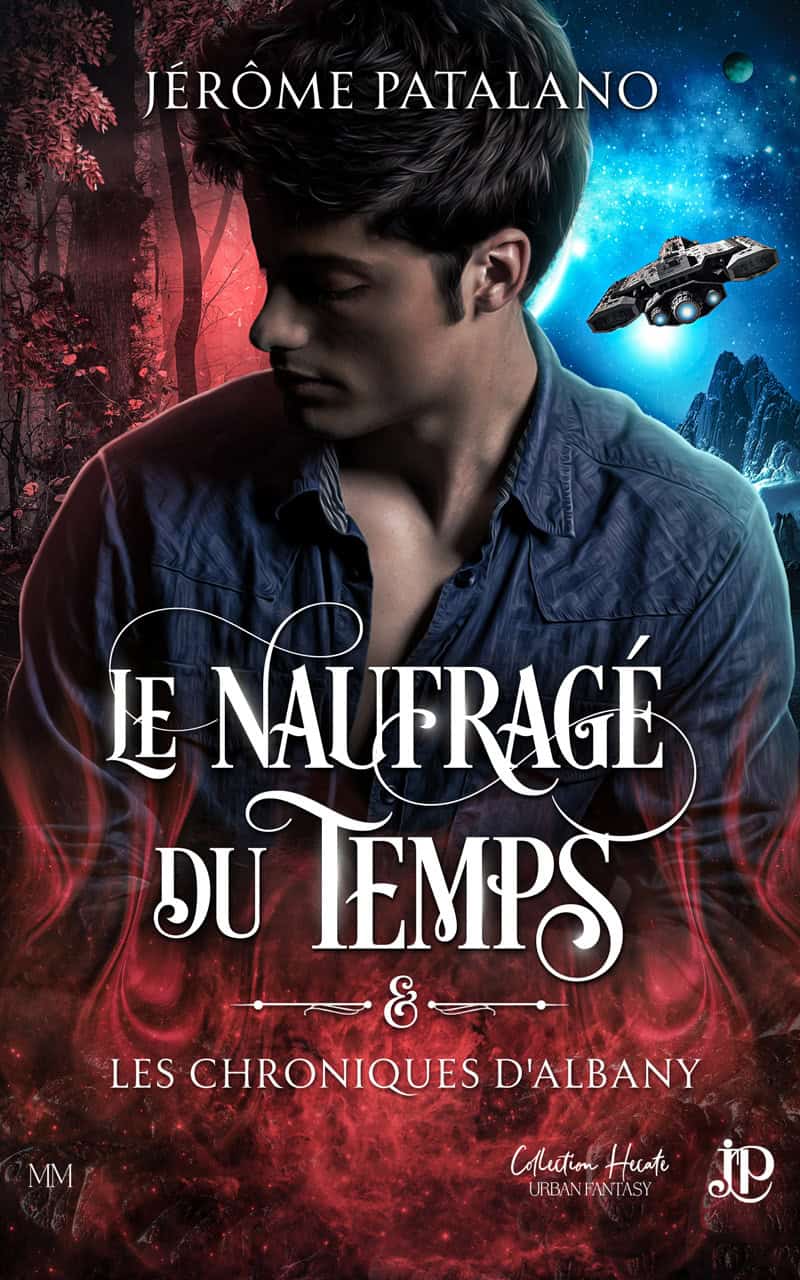
Découvrez ce livre
Nouveauté
Le naufragé du temps & les chroniques d’Albany
Imaginez : c'est comme si « Stranger Things » avait été croisé avec « Les nouvelles aventures de Sabrina ». Le tout, dans les années 90.
Découvrez ce livreBenedict embrasse sa queerness et Francesca découvre l’amour lesbien
La saison 3 a enfin franchi le pas. Benedict Bridgerton, l’artiste bohème de la fratrie, explore sa sexualité avec Lady Tilley Arnold et son amant Paul Suarez. Le trio partage des moments intimes qui confirment ce que les fans soupçonnaient depuis des saisons : Benedict est queer. L’acteur Luke Thompson livre une performance sensible d’un homme qui découvre une part inexplorée de lui-même. La showrunneuse Jess Brownell décrit Benedict comme quelqu’un qui « s’intéresse à l’esprit, à l’énergie, à la connexion », sans se focaliser sur le genre de son partenaire. Une forme de pansexualité assumée qui reflète une réalité historique souvent effacée : la fluidité sexuelle a toujours existé, même si l’époque refusait de la nommer (et ne savait pas également la nommer).
Mais le véritable coup de théâtre arrive avec Francesca. La benjamine discrète épouse Lord John Stirling dans un mariage tendre, mais dénué de passion. Tout bascule dans les dernières minutes de la saison lorsqu’elle rencontre Michaela Stirling, la cousine de son mari. Le trouble est immédiat, palpable, bouleversant. Dans les livres de Julia Quinn, ce personnage s’appelle Michael et devient le second mari de Francesca après la mort de John. En changeant le genre du personnage, la série annonce une romance lesbienne majeure. Ce choix audacieux, validé par l’autrice elle-même, ouvre la voie à une histoire d’amour queer qui promet d’être « la plus émotionnelle et déchirante » de la série, selon Quinn. Une fin heureuse garantie, car Bridgerton reste avant tout une célébration de l’amour sous toutes ses formes.

Un pied de nez aux anti-wokes et une réécriture nécessaire
Cette évolution n’est pas qu’une question de représentation, c’est aussi un acte militant. Faire exister des personnages LGBT+ dans une série d’époques, c’est rappeler une vérité historique constamment invisibilisée : les personnes homosexuelles et bisexuelles ont toujours existé. Elles vivaient, aimaient, désiraient, bien avant que la société ne leur accorde le droit de le faire ouvertement. Le choix de Shonda Rhimes de placer ces histoires au cœur de Bridgerton renverse les codes du genre. Les séries d’époque ont trop longtemps perpetué le mythe d’un passé exclusivement hétérosexuel et blanc. Bridgerton dynamite cette vision en proposant un univers où la diversité raciale et sexuelle est la norme, pas l’exception.
Tant pis pour les anti-woke qui hurlent au révisionnisme historique.
Et tant pis pour les anti-woke qui hurlent au révisionnisme historique. D’abord, parce que Bridgerton n’a jamais prétendu être un documentaire, mais bien une romance moderne dans un décor d’époque. Ensuite, parce que cette représentation compte : elle permet à des millions de jeunes LGBT+ de se voir enfin dans une fiction mainstream, de comprendre que leur existence n’est pas une anomalie du 21ème siècle, mais une continuité historique.

Des romans aux écrans : ce que la série change (et pourquoi c’est bien)
Bridgerton s’inspire de la saga littéraire de Julia Quinn, une romancière américaine spécialisée dans les romances historiques. Publiée entre 2000 et 2006, la saga compte huit romans principaux, un par membre de la famille Bridgerton. En France, c’est J’ai Lu qui édite la collection depuis 2008, avec des rééditions collectors qui cartonnent depuis le succès de la série. Julia Quinn s’est vendue à plus de dix millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis et ses livres sont traduits dans trente-sept langues. Son style s’inspire de Jane Austen tout en modernisant les codes : exit les héroïnes soumises des romances, place à des femmes fortes et des hommes qui apprennent à les respecter.
Mais la série prend des libertés salutaires avec le matériau d’origine. Dans les livres, aucun des frères et sœurs Bridgerton n’est queer. Benedict épouse Sophie Beckett, une femme, dans un récit inspiré de Cendrillon. Francesca tombe amoureuse de Michael Stirling, un homme. La diversité raciale est également absente des pages écrites par Quinn. Ces changements ne trahissent pas l’esprit des livres, ils l’enrichissent. Julia Quinn elle-même, soutient ces évolutions : elle a confié que, dès la lecture du livre de Francesca, elle s’était identifiée en tant que femme queer aux thèmes d’altérité et de différence qui traversent le récit. Le changement de Michael en Michaela lui semble donc cohérent et profondément émouvant.
Autre différence majeure : l’ordre des histoires. La série bouleverse la chronologie des livres pour des raisons narratives. La saison 3 adapte le quatrième roman centré sur Colin, tandis que la saison 4 devrait enfin raconter l’histoire de Benedict, héros du troisième livre. Ce choix permet d’explorer sa queerness avant de le faire rencontrer Sophie, offrant ainsi une profondeur supplémentaire au personnage.

Chez Poptimist, cette saison 4 s’annonce comme une promesse enfin tenue. On espère que Benedict et Francesca auront le traitement qu’ils méritent, avec des arcs narratifs aussi fouillés et romantiques que ceux de leurs frères et sœurs. Parce que représenter l’amour queer, ce n’est pas une case à cocher sur une to-do list inclusive, c’est offrir enfin de la visibilité à des millions de personnes qui existent depuis toujours, mais qu’on a trop longtemps effacées des récits. Alors oui, on attend cette saison 4 avec impatience. Et on a hâte de voir les anti-woke s’étrangler devant leur écran. Rendez-vous le 29 janvier 2026.

Jérôme Patalano est un auteur édité et auto-édité de romans d’imaginaire, feel-good et thrillers, avec des personnages queers, et consultant free-lance en communication digitale.
Enfant des années 80 et ado des années 90, la pop-culture a toujours guidé sa vie, jusqu’à la création de plusieurs médias comme Poptimist, mag de pop-culture queer (et pas que).


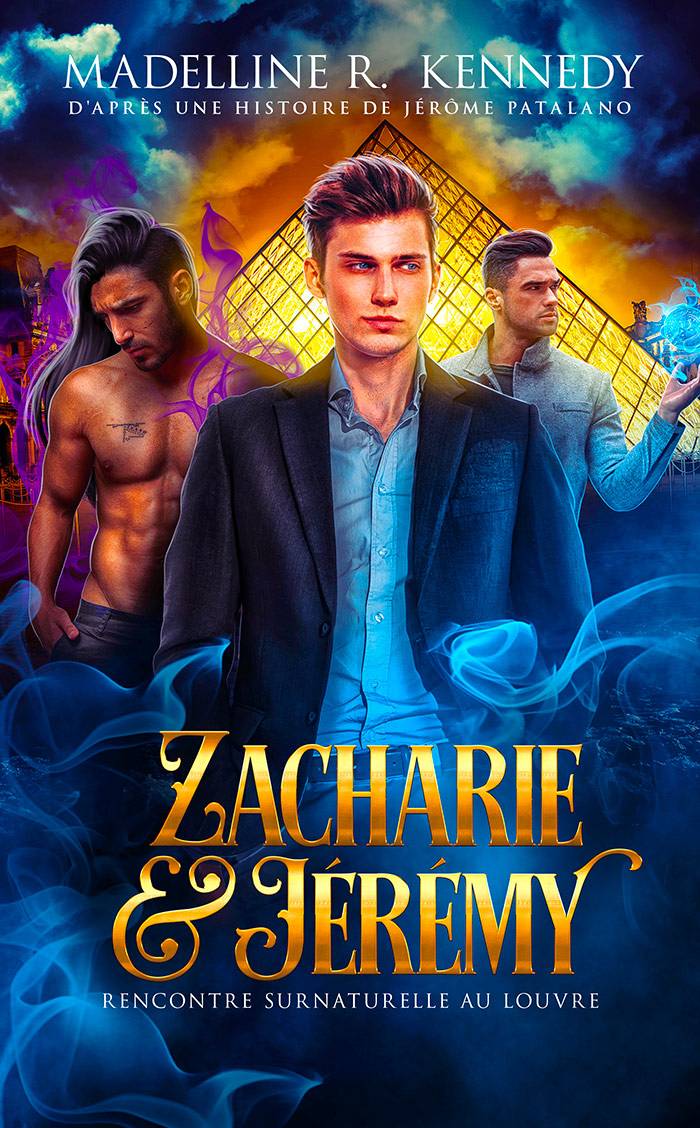
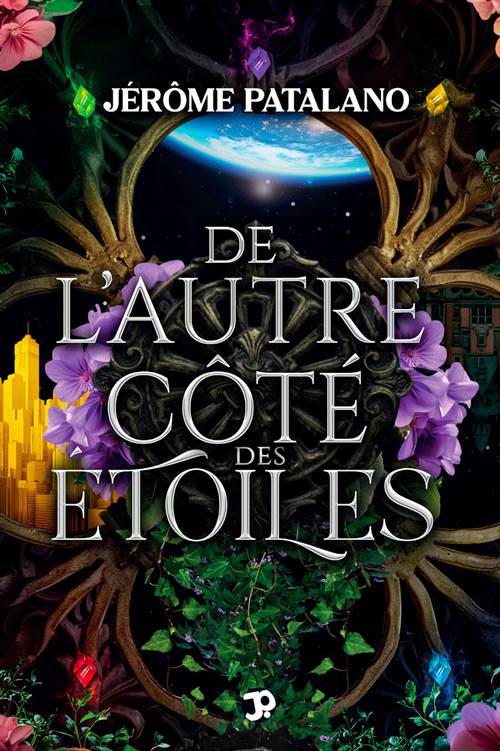


Les commentaires sont validés en amont par l'éditeur. Tout commentaire enfreignant les règles communes de respect en société ne sera pas publié.