« All’s Fair » sur Disney+ : pourquoi tout le monde déteste (et regarde quand même) la dernière série de Ryan Murphy avec Kim Kardashian ?
Écrit par Jérôme Patalano - Publié le 17 novembre 2025 - 🕐 7 minutes
Ryan Murphy vient de signer ce qui pourrait être le plus grand accident télévisuel de sa carrière. « All’s Fair », diffusée depuis le 4 novembre sur Disney+, cumule les pires critiques tout en devenant paradoxalement… le show le plus regardé de la plateforme.
« Camp », clinquant, consternant : bienvenue dans l’univers d’« All’s Fair », le nouveau drame judiciaire de Ryan Murphy qui suit un cabinet d’avocates spécialisées dans les divorces de luxe à Los Angeles. Portée par Kim Kardashian entourée d’un casting cinq étoiles (Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts), la série devait être l’événement glamour de l’automne. Elle est devenue un phénomène d’un autre genre : celui qu’on adore détester.
Ce qui sera abordé :
Quand Ryan Murphy transforme le barreau en podium de défilé
« All’s Fair » raconte l’histoire d’Allura Grant (Kim Kardashian), une redoutable avocate qui dirige un cabinet exclusivement féminin avec ses associées Liberty Ronson (Naomi Watts) et Emerald Greene (Niecy Nash-Betts). Face à elles, l’impitoyable Carrington Lane (Sarah Paulson), une ancienne collègue qui leur voue une rancune tenace depuis dix ans. Entre procès expéditifs, trahisons conjugales et dialogues surréalistes, la série jongle entre soap opera et procédure juridique sans jamais vraiment choisir son camp.

Le résultat ? Un patchwork stylistique où les costumes Jean Paul Gaultier vintage côtoient des répliques dignes d’un mauvais soap des années 80. Dans un épisode, Kim Kardashian apparaît en tailleur à dos nu laissant apparaître un string bordeaux, provoquant l’hilarité générale sur les réseaux sociaux. La garde-robe devient presque un personnage à part entière, éclipsant totalement l’intrigue juridique pourtant censée structurer le récit.
Sans parler du scénario, écrit avec les pieds. Non cohérence dans l’enchaînement des scènes, les dix premières de l’épisode 1 expédiées à vitesse grand-V pour nos poser le décor sans même qu’on ait le temps de souffler… Non, rien ne va.
Le massacre critique qui unit (enfin) la presse mondiale
Rarement une série aura fait l’unanimité aussi vite. « All’s Fair » a en effet atteint le score historique de 0% sur Rotten Tomatoes lors de sa sortie, avant de péniblement grimper à 4%. The Times qualifie le show de « peut-être la pire série dramatique de tous les temps », tandis que The Guardian évoque une œuvre « fascinante, incompréhensible, existentiellement affreuse ». The Telegraph ne mâche pas ses mots en décrivant Ryan Murphy comme « le grand prêtre de la télévision de mauvais goût » avec cette « série d’horreur hallucinante ».
En France, Les Échos parlent de série « clinquante et creuse », tandis que Konbini souligne le « péché capital du mélodrame kitsch qui est d’être spectaculairement ennuyeux ». Même les critiques les plus modérées peinent à trouver des qualités au show. Le Hollywood Reporter pointe le jeu « raide et sans émotion » de Kim Kardashian, comparant ironiquement sa présence à celle d’un personnage de jeu vidéo « subissant les événements tandis que tout le monde autour d’elle sourit et acquiesce ».
La comparaison la plus cinglante revient au Times : « Kim Kardashian est au cinéma ce que Gengis Khan est à la démocratie libérale et pacifique. » Aïe.

Kim joue l’avocate qu’elle n’est pas encore (pour l’instant)
L’ironie de la situation atteint son paroxysme lorsqu’on apprend que Kim Kardashian vient d’échouer, début novembre 2025, à l’examen du barreau de Californie. Après six années d’études de droit et quatre tentatives ratées au « baby bar » avant de finalement le réussir en 2021, la star a partagé sur Instagram avec autodérision : « Bon… Je ne suis pas encore avocate, j’en joue juste une très bien habillée à la télévision. »
Son parcours juridique, inspiré par son père Robert Kardashian (célèbre avocat d’O.J. Simpson), reste donc en suspens. L’examen du barreau californien, réputé pour sa difficulté avec seulement 63,6% de réussite, comprend cinq dissertations d’une heure, une épreuve pratique de 90 minutes et 200 questions à choix multiples. Kim devra le repasser, alimentant encore davantage le décalage surréaliste entre sa fiction télévisuelle et sa réalité juridique.
Glenn Close, Sarah Paulson : mais pourquoi diable ont-elles signé ?
C’est LA question qui hante les spectateurs : comment des actrices aussi respectées que Glenn Close (trois Oscars, trois Emmy) et Sarah Paulson (Emmy pour American Crime Story) ont-elles pu accepter de participer à ce naufrage ? Naomi Watts elle-même a admis avoir accepté le rôle sans lire « une seule ligne » du scénario, uniquement par confiance envers Ryan Murphy.

Glenn Close a évoqué « un groupe de femmes puissantes, drôles et solidaires » sur le tournage, Sarah Paulson s’est dite « amusée » par certaines répliques. Mais le résultat à l’écran raconte une tout autre histoire : celle d’actrices talentueuses noyées dans un matériau indigne de leurs compétences, récitant des dialogues comme « de cock rings à cocktails, tout ça en 24 heures » ou « mes seins piggly wiggly » avec un sérieux désarmant.
Scream Queens rencontre Dynasty : le camp qui rate sa cible
Ryan Murphy maîtrise habituellement l’art délicat du camp. Scream Queens (2015-2017) était une masterclass d’excès assumé, jouant sur les codes du slasher avec un second degré jubilatoire. « All’s Fair » semble vouloir emprunter cette voie, mais s’égare en route. Pour rappel, le « camp » (prononcez : « kemmmp ») se définit par : l’amour de l’artifice et de l’exagération, avec une certaine théâtralité.
Le problème ? La série ne sait pas si elle veut être prise au sérieux ou non. Elle oscille entre drame juridique prétentieux et soap opera déjanté sans jamais assumer pleinement ni l’un ni l’autre. Les affaires de divorce sont résolues en quelques minutes avec une facilité déconcertante, les personnages enchaînent les jets privés et les ventes aux enchères de bijoux après qu’une cliente s’est jetée d’un balcon. Le ton est tellement incohérent qu’on ne sait plus si on doit rire, pleurer ou éteindre la télévision.
Le phénomène « hateful watch » qui défie toute logique
Malgré ce carnage critique, « All’s Fair » cartonne. La série est devenue le titre le plus regardé sur Disney+ dans 28 pays, numéro un mondial de la plateforme. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont électriques. « C’est la série la plus cheese, la plus camp, la plus prévisible mais aussi la plus addictive », écrit un spectateur. « Ça comble le vide laissé par Scream Queens et j’en veux encore. »
“All’s Fair”, c’est Scream Queens pour les mamans qui boivent du vin et les gays millénials
Ce succès paradoxal illustre un phénomène de « hateful watch » : ces séries qu’on regarde précisément parce qu’elles sont mauvaises. Les filles et les gays, public cible non avoué de Murphy, se délectent de chaque excès vestimentaire, de chaque réplique absurde, transformant le show en mème vivant. « “All’s Fair”, c’est Scream Queens pour les mamans qui boivent du vin et les gays millénials », résume parfaitement un tweet viral.
Les spectateurs partagent leurs répliques préférées (« il y a des rumeurs sur toi… je les ai lancées »), commentent les tenues improbables, créent des montages TikTok. La série devient un objet culturel décalé, consommé au second degré comme un Real Housewives scriptée ou un Selling Sunset sous stéroïdes.

Ryan Murphy sans garde-fou ? L’excès pour l’excès !
Anthony Hemingway, réalisateur de plusieurs épisodes, tente de défendre le projet en le comparant à The Wire (si, si, il a osé). Il évoque « un espace de fantasme, pensé comme une échappatoire où tout n’est pas pris au sérieux ». Le problème ? Personne ne sait vraiment si c’est de l’humour intentionnel ou de l’incompétence assumée.
Car « All’s Fair » révèle surtout les failles du système Murphy : un producteur devenu trop puissant, capable d’aligner un casting de rêve et un budget pharaonique sans qu’aucun garde-fou créatif ne vienne tempérer ses excès. Les trois premiers épisodes, co-écrits par Murphy lui-même avec Jon Robin Baitz et Joe Baken, confirment qu’il a « perdu toute capacité à ancrer son écriture dans des émotions humaines relatables ».
La série fonctionne davantage comme un catalogue publicitaire géant que comme une œuvre narrative cohérente : Hermès, Gucci, Chanel, jets privés, Le Bernardin, Sotheby’s. Chaque scène ressemble à une page de magazine de luxe, belle à regarder mais vide de substance. Time résume parfaitement : « L’expérience de regarder “All’s Fair”, c’est comme feuilleter un magazine féminin haut de gamme, en s’attardant sur les shootings mode mais sans jamais lire un article en entier. »
Alors oui, « All’s Fair » est probablement le pire show de Ryan Murphy. Oui, Kim Kardashian devrait peut-être s’en tenir à la téléréalité. Oui, Glenn Close méritait mieux. Mais dans ce désastre fascinant se cache aussi quelque chose de jubilatoire : le plaisir coupable de voir Hollywood s’effondrer dans ses propres excès. Comme le dit si bien Variety, c’est « un fantasme de girlboss maladroit et condescendant », mais c’est NOTRE fantasme de girlboss maladroit. Et franchement, après une journée pourrie, qu’y a-t-il de mieux que de regarder des femmes millionnaires en Louboutin se venger de leurs maris infidèles avec des dialogues improbables ? « All’s Fair » n’est peut-être pas de la bonne télévision, mais c’est indéniablement de la télévision fascinante. Le genre de train wreck dont on ne peut détacher les yeux. Et pour ça, merci Ryan. Ou pas.

Jérôme Patalano est un auteur édité et auto-édité de romans d’imaginaire, feel-good et thrillers, avec des personnages queers, et consultant free-lance en communication digitale.
Enfant des années 80 et ado des années 90, la pop-culture a toujours guidé sa vie, jusqu’à la création de plusieurs médias comme Poptimist, mag de pop-culture queer (et pas que).

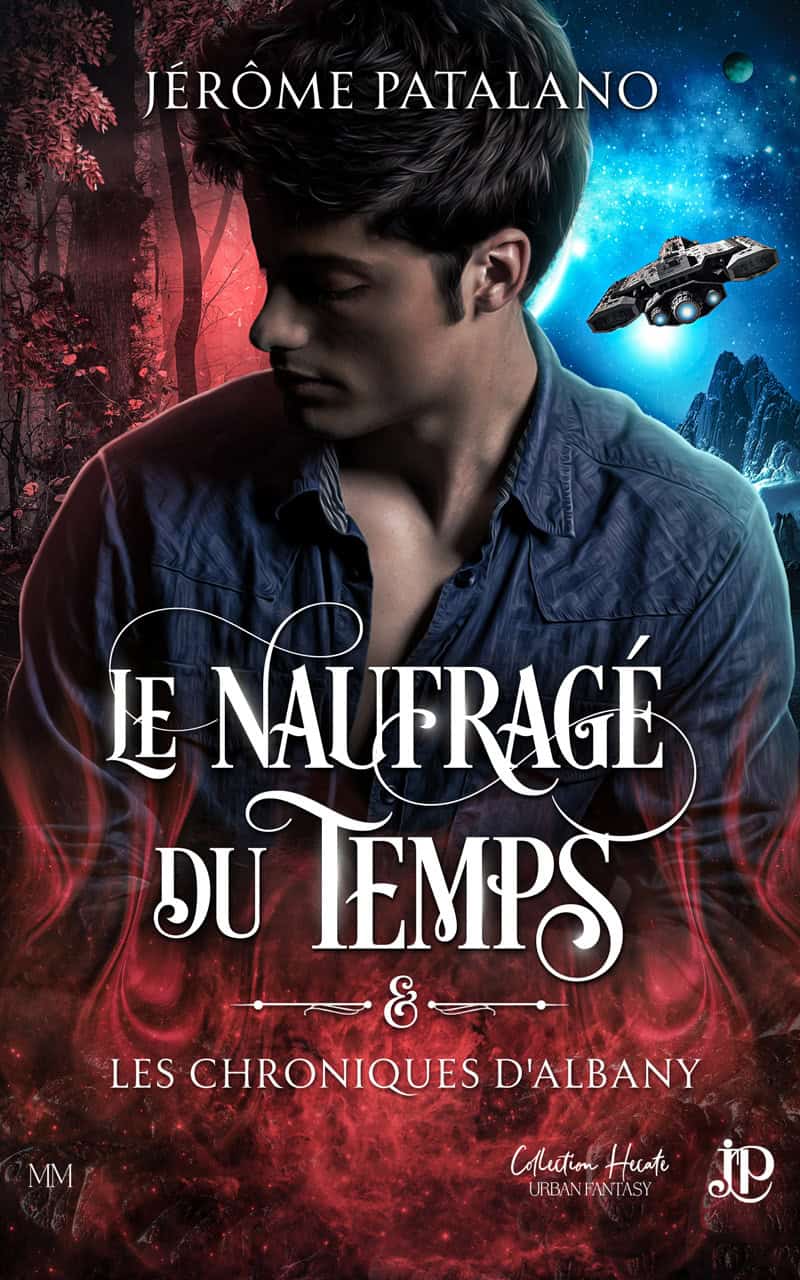

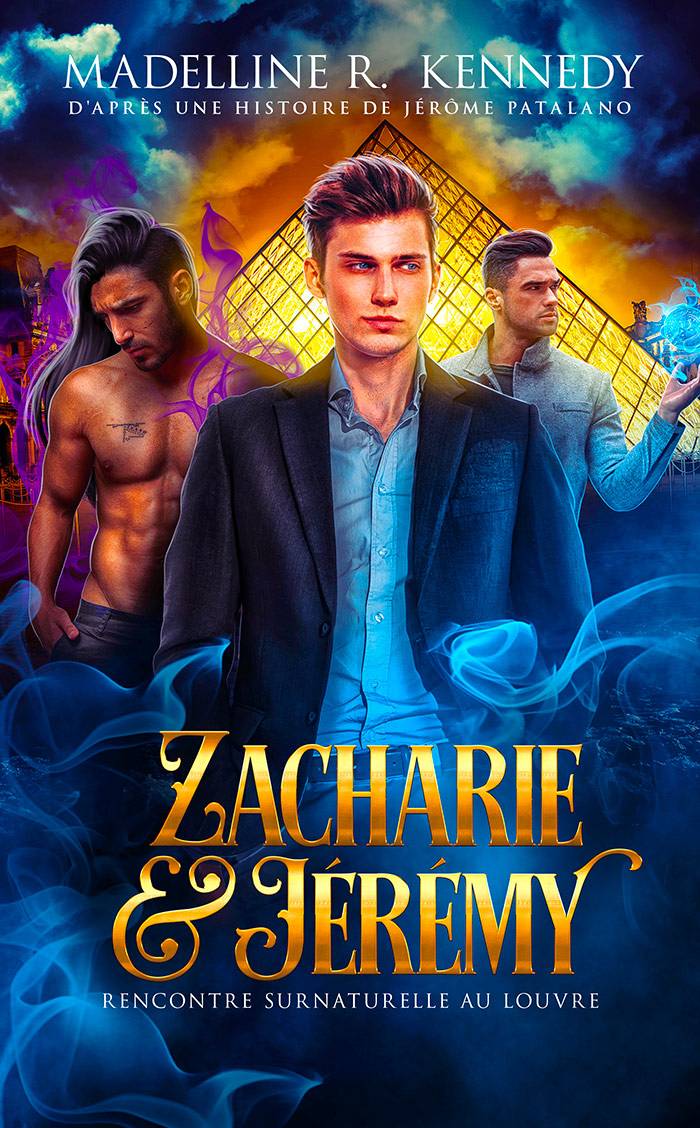
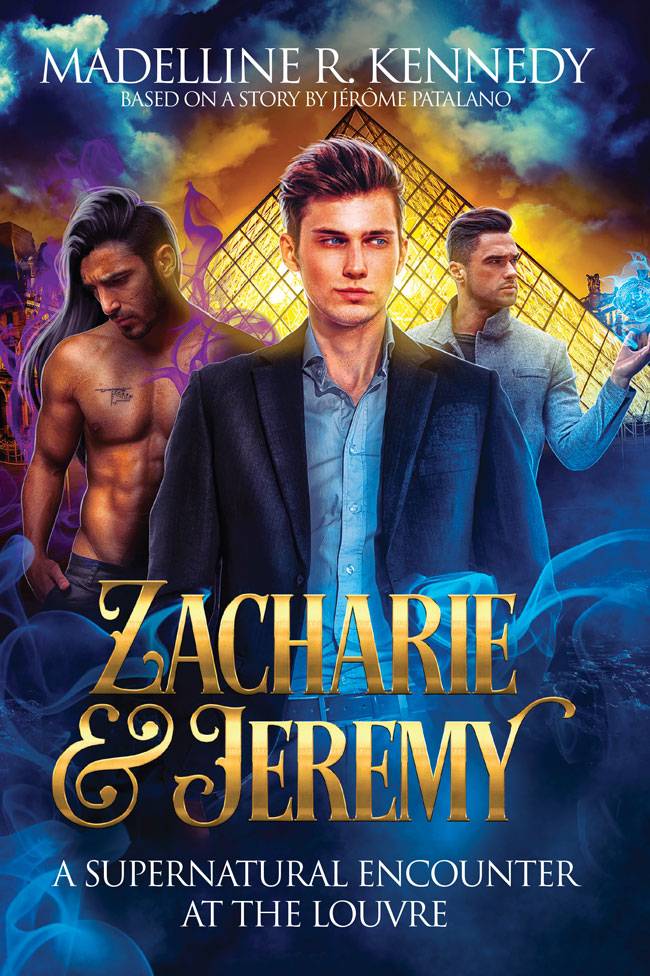


Les commentaires sont validés en amont par l'éditeur. Tout commentaire enfreignant les règles communes de respect en société ne sera pas publié.